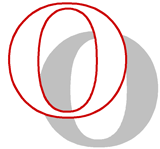Observatoire Chrétien de l'Entreprise et de la Société
L'OCHRES exerce une mission d'observation des problèmes économiques et sociaux, particulièrement de ceux qui relèvent des interactions entre l'entreprise et la société.
La crise syrienne remet-elle en cause les principes de la "guerre juste"?
Telle est la question qui m’a été posée par l’OCHRES. Question légitime sans doute puisque, à la lecture par exemple d’un article du Monde, daté du 6 septembre, nous pouvons voir que la question d’une punition de Bachar Al-Assad après l’attaque chimique du 21 août « oppose les intellectuels » et que la « complexité de la situation syrienne fait bouger les lignes de pensée habituelles »(1). La réflexion qui suit est délibérément située dans le champ de la pensée sociale et politique chrétienne ; elle ne vise pas à prendre position, mais cherche à mettre de l’ordre dans le recours qui est fait au discours chrétien, recours qui va de l’invocation comme référence absolue à la révocation comme étant inadapté aux situations concrètes.
1- Avant de faire appel aux principes de la « guerre juste », il faut rappeler dans quelle perspective se situe toute question sur les rapports internationaux, en particulier sur les conflits. La réponse chrétienne est très claire et essentielle : le sens de l’histoire, dans la vision chrétienne, c’est la construction d’un monde réconcilié avec le Christ et avec lui-même. C’est la vision d’Isaïe, la Cité sainte de l’Apocalypse, la perspective dressée par s. Paul au début de la Lettre aux Éphésiens. C’est la mission de l’Église, qui a reçu le « ministère de la réconciliation » (2 Co 5, 18). Cette réconciliation est aussi la finalité de la doctrine sociale de l’Église : La doctrine sociale trace les voies à parcourir vers une société réconciliée et harmonisée dans la justice et dans l’amour, qui anticipe dans l’histoire, d’une manière inchoative et préfigurative ‘des cieux nouveaux et une terre nouvelle’ (Compendium, 82). Cette perspective n’est pas une vague ambition de l’Église, c’est une obligation concrète qui engage à tous les étages la société des croyants – individus, groupes, institutions, nations, organisations supranationales – et qui constitue un champ essentiel du dialogue avec le reste du monde. En conséquence, l’Église ne peut penser la guerre que dans une perspective de paix : « On ne peut entreprendre une guerre que si l’on voit clairement que le seul but recherché est la paix » (s. Augustin, De officiis 1,11).
2 - Dans ce cadre, les chrétiens, avec tous les hommes soucieux de la construction de ce monde pacifié, sont appelés à contribuer à la création, à la mise en œuvre et au développement d’outils de la paix. Ces outils peuvent être des institutions, et notamment toutes les institutions de gouvernance mondiale, qui se conçoivent comme un bien commun, à la perfection et à l’efficacité desquelles tous les efforts doivent être orientés. Ce peut être aussi des initiatives, comme des initiatives spirituelles (jeûnes et prières) ; des rencontres (publiques ou plus discrètes comme a pu en faire la communauté San Egidio) ; ou plus simplement les dialogues entre confessions chrétiennes séparées ou entre représentants religieux. Ce peut encore être la contribution à un corpus de références, de nature à donner des bases théoriques à la décision. Ajoutons, en tout état de cause, que tous les instruments de cette gouvernance mondiale ont pour socles la parole et le service des populations.
3- Parmi ces références, et en s’appuyant sur une théologie de la paix, toujours en maturation, l’Église a formulé une réflexion sur au moins deux champs qui nous intéressent s’agissant de la crise syrienne : le droit d’ingérence et les principes de la guerre dite « juste ».
A. Le « droit-devoir d’ingérence »(2), qui apparaît dans le corpus international avec la résolution 43-131 de l’Assemblée générale des Nations-Unies (1988) est un principe jeune, qui a pris de la solidité avec la crise de Bosnie-Herzégovine. L’Église l’a fait sien dès 1992 (3); les critères suivants sont mis en avant : « violation grave, intolérable et répétée des droits fondamentaux de la personne humaine ; estimation que l’intervention n’entraînera pas des conséquences pires que les maux auxquels elle est censée remédier ; recours en dernier ressort ».
B. La notion de guerre « juste »(4), qu’on devrait plutôt appeler « droit du recours à la force », s’est forgée avec le temps et les principes ont évolué. Nous pouvons les résumer ainsi : 1. L’agresseur contre qui le recours à la force est envisagé doit causer des maux constatables, graves, durables ; 2. L’opération peut être envisagée si toutes les autres voies ont échoué, notamment le dialogue ; 3. L’opération doit être décidée par une autorité légitime ; 4. L’opération ne peut s’envisager que si elle a des chances sérieuses de réussite ; 5. Elle ne doit pas occasionner des maux plus grands que ceux auxquels elle est censée remédier ; 6. Elle doit même constituer une étape dans la recherche d’une paix durable. On peut ajouter d’autres critères moraux à la lumière des opérations de ces dernières années : est suspecte toute opération qui vise à favoriser des intérêts particuliers (maintenir une position forte dans une région par exemple)(5) ; discutable toute opération qui ferait périr des innocents (civils par exemple)(6) ; infondée une opération qui se déciderait sur la base d’observations partielles, insuffisamment recoupées (7); etc.
L’examen de la situation syrienne tend à montrer – on aurait envie de dire sans ambiguïté – qu’une opération militaire même limitée, décidée comme l’a dit un moment le Président français pour « punir le dictateur syrien » sans mandat de l’ONU, ne remplissait pas tous ces critères, loin s’en faut, et donc qu’elle n’avait pas de légitimité au sens du droit de la communauté internationale ; et pas non plus de légitimité au sens de la morale politique. D’ailleurs, la seule évolution du dossier depuis août dernier a clairement montré que la position française officielle de départ, partagée il faut le souligner par quelques personnalités expérimentées dans l’opposition, était intenable.
4- Dans cet article on croit volontiers que l’utilisation d’armes chimiques dans la banlieue de Damas le 21 août dernier est le fait du gouvernement syrien, et on ne s’attarde pas sur le fait de savoir si cette utilisation a été validée par Bachar Al-Assad lui-même, ce qui ne change pas en profondeur l’analyse. De ce fait, donc, on pourrait considérer que la condition 1 de l’ingérence ou du droit du recours à la force est remplie. On ne peut pas toutefois ne pas s’interroger sur le comportement des rebelles en matière d’atrocités voire d’utilisation d’armes chimiques également. Les maux sont constatables et vont croissants, les droits élémentaires des personnes humaines sont piétinés, l’ingérence est justifiée, mais la stigmatisation d’un camp n’affaiblissait-elle pas les tenants du recours à la force ?
5 - La recherche du dialogue a-t-elle été conduite, de manière équitable, persévérante, avec des ébauches de solution de manière à mettre en application le principe « du dernier recours » ? D’évidence non. Ou alors on a été gravement infécond et il est urgent de changer de méthodes. Certaines puissances dont la France se sont arrogé le droit de dire qui pouvait parler avec qui, non sans se déjuger plusieurs fois sur les personnes et sur les groupes. Dans ce dossier, l’exigence du dialogue est oubliée depuis le début. Maintenant, il faut être réaliste : ce dialogue était-il possible, quand on voit comment ont évolué les groupes dit démocratiques, constitués par les Occidentaux, la montée en puissance de groupes rebelles, l’implication des pasdarans iraniens, ... ? Ainsi vient cette question : comment respecter ce principe quand le dialogue semble s’avérer impossible ?
6 - Y avait-il décision d’une autorité légitime ? Ce point est capital. Aujourd’hui la communauté internationale construit progressivement une gouvernance mondiale autour de l’ONU à qui sont confiées de nombreuses opérations de paix. L’avis de cette autorité était indispensable pour intervenir en Syrie, faute de quoi elle aurait sans doute perdu toute base pour d’éventuels conflits à venir. Des voix se sont élevées pour dire que cette attitude était un peu « faux-cul » - il n’y a pas d’autre expression -, au prétexte que ceux qui s’y tiennent savaient bien que le conseil de sécurité de l’ONU est bloqué par la Chine et surtout la Russie ; l’ONU serait donc inopérante, et quand elle est inopérante, on doit pouvoir s’en passer pour agir. Mais le problème est-il de montrer les biceps ou de bâtir une paix durable ? Dans le cas syrien, la question de la légitimité d’une autorité morale indépendante des nations est d’autant plus nécessaire qu’on s’est davantage aventuré dans le registre de la punition, en opérant un subtil passage de la paix à la justice. Où et comment se fonde le projet du chef d’État français de « punir » Bachar Al-Assad ? Peut-on punir sans juger, et juger équitablement ? Heureusement les faits ont conduit à remettre l’ONU au centre du jeu, et c’est probablement un bien dans une perspective de long terme comme de court terme.
7 - A supposer que la voie de frappes ait été mise en œuvre, l’opération avait-t-elle des chances de réussite ? Quel était son but : punir le dictateur ? chasser le dictateur ? installer au pouvoir les rebelles ? maintenir aussi les rebelles à l’écart ? mettre un terme à l’usage des armes chimiques ? confisquer ou détruire toutes les armes chimiques répertoriées sur le terrain ? donner un avertissement ? amener les parties autour de la table ? Les partisans d’une opération convergeaient-ils sur un objectif commun et clair ? Sans cet objectif partagé, il y avait peu de chances qu’il y ait réussite. Est-on, de plus assuré, qu’elle n’aurait pas entraîné la mort de civils innocents ? : était-on prêt à payer à ce prix une opération déjà contestable ?
8 - Y avait-il des risques qu’une telle opération puisse déboucher sur une situation pire que la situation actuelle ? Nous pouvons aborder la question autrement : une opération pouvait-elle être envisagée qui garantisse que la situation ne s’aggraverait pas ? Il y avait – il y a encore - plusieurs axes possibles d’aggravation : un axe géographique immédiat : on sait qu’en raison de la présence de nombreux réfugiés de l’autre côté des frontières ou en raison de l’animosité chiites-sunnites, ou encore à cause de la question kurde ou libano-syrienne, ou encore en raison de l’hostilité entre la Syrie et Israël, les tensions peuvent s’exporter dans les pays voisins. Un axe géographique plus large, dont des actes terroristes à l’encontre des intérêts occidentaux où qu’ils soient pourraient être la manifestation, doit être intégré à l’analyse. Mais il y a aussi la possibilité d’un degré de plus dans l’escalade de la violence en Syrie même, provoquée soit par les adversaires du pouvoir actuel, profitant de l’affaiblissement du camp Assad, soit des alliés d’Assad, décidés à frapper un grand coup pour sauvegarder leurs intérêts (les amis iraniens par exemple). Si la décision d’intervenir se fait sans l’aval de l’ONU, elle pourrait aussi mettre à mal la relation entre ceux qui parmi les puissances extérieures l’appuient et ceux qui y sont délibérément opposés, rendant très difficile le retour vers une instance de dialogue et donc la marche vers un chemin de paix.
9 - Enfin, y avait-il des indications claires qu’une telle opération allait être un grand pas vers la paix et que cette finalité était poursuivie avec persévérance ? Là encore, d’évidence non, je ne m’y attarde pas.
L’énoncé de ces questions semble déboucher très nettement sur une position défavorable à toute intervention qui ne serait pas précisée dans ses objectifs, validée par l’ONU, explicite sur les moyens d’éviter tout risque d’escalade, et claire sur le fait de savoir comment elle ouvre une voie de paix. C’est précisément la raison pour laquelle les voix qui constatent qu’avec ces principes, on laisse le sang couler, s’élèvent pour dire que ces approches appartiennent au passé et que le cas syrien nous oblige à « changer de logiciel » comme on dit maintenant. Trois séries de questions peuvent en effet conduire à penser autrement, c’est-à-dire à s’affranchir des principes habituellement observés : le cas syrien est une guerre civile très particulière ; l’escalade des moyens de conduire la guerre a atteint désormais des pratiques normalement rejetées par la communauté internationale ; la paralysie du Conseil de sécurité fait que devient inacceptable une situation qui n’a déjà que trop duré (réfugiés, destructions, ...) et qu’il faut faire cesser.
10 - L’ingérence dans une guerre civile : le cas syrien est spécifique en ceci que la situation actuelle trouve racine dans une guerre intestine dont l’origine date de décennies, qui s’est manifestée par des éruptions régulières, scandées par des massacres inhumains, la victoire d’un camp sur l’autre, puis la revanche de celui-ci sur celui-là. Le soulèvement de Deraa, en mars 2011, a gravement ravivé les haines réciproques, consolidé des zones d’exclusivité pour chaque camp, et fait monter la violence par degrés. Une partie de la communauté internationale a considéré que les personnes qui se soulevaient contre un pouvoir qui n’avait retenu que la force brutale comme argument pour leur répondre étaient globalement en état de légitime défense et pouvaient de ce fait être aidées. Le droit de légitime défense est prévu dans l’article 51 de la Charte des Nations-Unies. Mais est-on clair sur les victimes ? Peut-on mettre dans le même camp les rebelles, avec leurs contingents de djihadistes, les opposants tentés par une démarche démocratique, les civils qui ne demandent qu’à vivre ? Prendre le parti de s’opposer au seul camp du pouvoir avec la volonté de le « punir » est-ce prendre la défense des victimes ou soutenir la rébellion ? Au fond, le dialogue est-il possible dans le cas de guerres civiles ?
11 - La Syrie, de manière beaucoup plus aiguë que la Libye, avec laquelle des comparaisons sont souvent faites, est aussi un territoire sur lequel s’affrontent les intérêts spécifiques de plusieurs pays qui comptent dans la communauté internationale. Sa localisation dans l’est de la Méditerranée appréciée de plusieurs puissances militaires, dont la Russie ; son débouché maritime, qui intéresse l’Iran et l’Irak ; sa population sunnite soutenue par certaines monarchies du Golfe persique vivant dans la crainte du fameux « croissant chiite » ; l’intérêt historique de la France et de la Grande-Bretagne ; les interdépendances avec le Liban ; etc. Les grands pays du monde ont choisi leur camp – on pourrait dire leurs pions - de manière hétérogène : leur propre incapacité de dialogue nourrit l’incapacité de dialogue entre les parties syriennes sur le terrain, créant les conditions d’exigences difficilement réconciliables. Mais, contrairement à la Libye, où aussi bien Khadafi que ses adversaires avait peu d’amis, le théâtre syrien divise le monde. Quelle est la légitimité d’une implication de nations qui ont chacune sa propre vision, arme ses affidés, et dont certaines ont déjà prédécoupé le territoire en fonction de leurs intérêts, .... ?
12 - Cette « ingérence partiale » se complexifie quand on aborde la question des religions, qui clive sinon les dirigeants, du moins les opinions publiques. Clairement le président Poutine soutient les chrétiens orthodoxes ; et une partie de l’opinion publique en Europe se sent solidaire des chrétiens d’Orient : tous pourraient se rapprocher dans une sorte de mise à distance des musulmans, en particulier radicaux, les salafistes et les frères musulmans, d’inspiration sunnite, véhicules d’un islamisme intégriste, financièrement soutenu par de riches États du Proche-Orient : beaucoup de ces chrétiens redoutent une arrivée au pouvoir de ces groupes, qui signifierait pour eux élimination ou exil. Des raisonnements semblables sont perceptibles chez les chiites, déjà victimes des sunnites et du conflit syrien dans l’Irak voisin. Est-ce pour autant que ces musulmans n’auraient pas le droit de vivre sur leur propre terre ? Ce que nous désirons pour les uns (les chrétiens) sommes nous fondés à le refuser à d’autres ? Alors, faut-il donner un rôle aux communautés religieuses pour qu’elles prennent la responsabilité d’un dialogue ou au contraire les écarter pour résoudre la question selon des critères « laïcs » ?
13 - Au fond, le fait que le cas syrien est une guerre civile très complexe et particulière n’autorise sans doute pas à déclarer que les principes prudentiels rappelés plus haut ne fonctionnent plus. En effet, il met en évidence que l’intervention incohérente d’États qui s’impliquent de leur propre mouvement et tentent de bâtir des coalitions improbables aboutit à une impasse ; et qu’il n’y a pas de solution envisageable tant qu’une claire vision commune de ce que devra être la Syrie de demain, partagée tant par les parties sur le terrain que par les États qui y ont des intérêts importants, ne sera pas dégagée, à laquelle tout le monde s’attelle. C’est ce travail qui doit être fait, et qui manque peut-être de cadre dans la communauté internationale. Il ne s’agirait pas de s’affranchir des règles actuelles, mais de les compléter. En effet, l’évolution du conflit syrien depuis le mois de septembre a mis en évidence la nécessité absolue de l’épuisement des capacités de dialogue. Armer certaines parties en cause, choisir ses pions, dire qui est légitime et qui ne l’est pas a tué les possibilités de dialogue, fractionné les forces en présence, interdit toute avancée. Sous l’angle de la pensée chrétienne, ce principe se révèle comme le principe clef, loin devant tous les autres. Il faut peut-être lui donner plus de possibilités concrètes.
14 - L’utilisation des armes chimiques ne fait-elle pas entrer dans un autre contexte, elle aussi ? D’autant qu’un avertissement clair avait été donné par les États-Unis, sous le terme de « ligne rouge à ne pas dépasser ». Le problème pourrait être abordé en ces termes : la communauté internationale, précisément pour avancer vers un monde de relations plus confiantes et pacifiées, se fixe des règles, dont l’interdiction des armes chimiques ; a fortiori un dirigeant qui y recourrait contre son propre peuple, décision inique s’il en est, ne pourrait être admis dans cette communauté, un peu comme l’invité au festin royal qui n’a pas mis la tenue convenable. Il doit être rejeté, sans que cela nuise à son pays, qui lui devra être réintégré dans la communauté des nations.
Nous entrons là dans le registre de la répression pénale internationale. Si les preuves sont là, l’ONU pourrait être fondée à autoriser l’opération proportionnée pouvant aboutir à ce résultat. Si le conseil de sécurité ne prend pas la décision à cause des blocages de certains de ses membres, alors l’Organisation pourrait perdre de sa crédibilité dans sa mission de gouvernance mondiale, qui n’est pas seulement de donner le feu vert, mais de calibrer et d’encadrer l’opération dans un processus orienté vers la paix. Il est néanmoins possible de contourner l’obstacle en réunissant l’Assemblée générale. Il est vraisemblable que la seule attestation des preuves qu’une attaque de grande ampleur a bien été organisée par le régime a pu ramener les grandes nations vers la table des négociations, et c’est pour cela que cette exigence de fournir les preuves, délibérément soutenue par Ban Ki Moon, était une étape incontournable. Mais pour permettre de passer à la case « opération militaire ciblée », il faudrait effacer deux fragilités : est-on bien certain que la partie rebelle n’a pas usé de telles armes ou pratiqué des crimes de guerre qui la mettraient au même plan sous l’angle moral que le gouvernement de Bachar al Assad ? (8) Les nations intervenantes sont-elles les mieux placées pour « sanctionner » ou même prendre la main d’une conférence de paix quand elles ont contribué à l’armement des parties et à l’escalade de la violence ? L’utilisation des armes chimiques par le gouvernement syrien change-t-elle donc la donne au point de rendre légitime un État ou un groupe d’États qui déciderait de se passer de l’avis des Nations-Unies ? Celles-ci, au contraire, qui, en outre, interviennent depuis le début sur le terrain pour des motifs humanitaires, ne gardent-elles pas une légitimité infiniment supérieure à celle des nations qui aujourd’hui se sont mises en avant ?
15 - La dimension terroriste peut, elle aussi, amener à s’interroger sur l’actualité et l’efficience des principes prudentiels de la communauté internationale. Après le 11 septembre 2001, les États-Unis se sont engagés dans la traque des dirigeants du réseau Al-Qaïda où qu’ils aient été. La France a pris la tête d’une opération anti-terroriste au Mali contre des cellules islamiques qui avaient ciblé ses ressortissants et qui menaçaient ses intérêts. Elle l’a fait dans le cadre d’une coalition internationale, avec l’aval de l’ONU. Celle-ci a condamné clairement le terrorisme lors de son sommet de 2005, et mène des actions de coordination des États membres, notamment dans le cadre d’une stratégie antiterroriste mondiale. Mais celle-ci peut sembler insuffisamment efficace. Les exemples actuels des États-Unis et de la France peuvent conduire à considérer qu’il est légitime que toute nation victime d’actes terroristes en poursuive les auteurs où qu’ils soient dans le monde, comme a accoutumé de la faire par exemple Israël. Dans le cas syrien, les auteurs d’actes terroristes sont majoritairement, semble-t-il, du côté des rebelles. Des pays voisins donc, comme l’Iran ou l’Irak, pourraient légitimement s’engager ensemble ou unilatéralement pour « punir » les rebelles sunnites sur le territoire syrien. On voit bien que cette perspective débouche sur l’inutilité d’une gouvernance ou d’une instance de modération mondiale et peut contribuer à l’extension du conflit.
Il ne semble donc pas que l’utilisation des armes chimiques, telle que l’a entreprise le gouvernement syrien, puisse justifier d’un abandon des principes qui tendent à encadrer le recours à la force entre nations. Bien au contraire, elle semble imposer une appréciation équilibrée des responsabilités des parties en présence ; toute opération concrète envisagée devra viser à identifier et neutraliser aussi bien les auteurs d’actes terroristes que les responsables d’attaques chimiques et à leur faire rendre compte de leurs actes. On ne voit pas qu’une coalition partisane puisse aller dans ce sens. Mais la communauté internationale a le devoir d’agir, faute de quoi les condamnations officielles qu’elle a proclamées, tant des armes chimiques que du terrorisme, perdront de leur crédibilité au point de ne plus pouvoir les empêcher.
16 - C’est pourquoi certains intervenants pensent qu’il faut agir d’urgence, ne serait-ce que pour « faire la police », faire respecter les règles communes. Aujourd’hui cela semble impossible en raison du blocage du Conseil de sécurité par deux de ses membres, la Russie et la Chine, qui sont hostiles à toute ingérence. S’il s’agit de faire la police, il faut le faire légalement, car on ne peut faire respecter la règle en l’enfreignant. Il ne s’agit donc pas de cela : le blocage des Nations-Unies est scandaleux parce que la situation sur le terrain est depuis déjà longtemps inacceptable : des dizaines de morts, souvent innocents, chaque jour depuis deux ans et demi ; des blessés graves avec des handicaps à vie, se comptant par dizaines de milliers ; deux millions de réfugiés dans les pays voisins ; des conditions élémentaires d’existence qui ne sont pas garanties ; des enfants qui ne vont plus à l’école ; etc. Sous cet éclairage, les projets régulièrement reportés de conférence à Genève, les inspections de l’ONU, les actions qui s’inscriraient dans l’éthique de la gouvernance mondiale ne fonctionnent pas. Mais n’est-ce pas précisément l’absence de dialogue des membres du Conseil de sécurité et l’ingérence d’États soucieux de leurs intérêts qui causent cette paralysie ? Les Nations-Unies ont su placer ailleurs des couloirs humanitaires. Elles pourraient inventer les processus d’une désescalade progressive (la mise sous contrôle international des arsenaux chimiques éviterait que ceux-ci tombent entre les mains djihadistes, constituant un premier pas). L’idée d’une partition provisoire du territoire en fonction des parties en cause (alaouites, chrétiens, druzes, sunnites, chiites, ...), permettant dans chaque camp le repérage ou la formation de personnalités dignes de confiance et l’ouverture d’un dialogue équilibré, peut-elle être envisagée, comme celle des conditions d’un armistice ou d’une reviviscence moderne de la Trêve de Dieu des temps médiévaux ? En d’autres termes, si les nations qui se sont mises en avant avec leur désir de frappe punitive s’étaient depuis longtemps impliqués pour aider l’ONU a créer des conditions d’existence acceptables pour les victimes, elles seraient sans doute plus crédibles et contribueraient à consolider le rôle de modérateur de l’ONU.
Se placer dans la « seule » perspective de la paix implique, dans la référence chrétienne, d’avoir l’idée du recours à la parole avant de penser à recourir à la force. Et les chrétiens peuvent mettre sur la table des expériences et des savoir-faire basés sur « la diplomatie de la force faible » qui ont fait leurs preuves, comme l’a fait la Communauté Sant Egidio (9). Incontestablement, le tableau ci-dessus le montre, le cas syrien a été privé de cette dynamique de la réconciliation et la situation actuelle en est la conséquence directe. Peut-on revenir en arrière ? la menace de la force est-elle de nature à faciliter le retour du dialogue ou les conditions d’un dialogue équilibré ? l’utilisation des armes sous la pression de quelques nations, y compris avec mandat de la communauté internationale, peut-elle vraiment être un chemin de paix ? La relecture des principes prudentiels sur le recours à la force et sur l’ingérence reste efficace pour se poser de bonnes questions dans une problématique qui donne large champ au passionnel, aux positions partisanes, aux exagérations, aux calculs politiciens.
Elle conduit à cette conclusion : ce que l’humanité a construit pour faire émerger une communauté, ces institutions sous l’égide de l’ONU, ces traités, ces principes qui expriment l’intuition que la parole est plus forte que la violence, n’est-ce pas cela qui porte les possibles d’un monde réconcilié, fragile chemin de sens que tout homme sage et responsable devrait respecter et consolider ? Et cette constatation que les peuples ont été dans cette question beaucoup moins va-t-en guerre que leurs représentants ne donne-t-elle pas aussi beaucoup à méditer ?
Hervé L’Huillier
Dernière modification : 22/10/2013