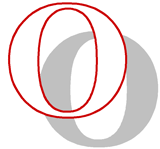Observatoire Chrétien de l'Entreprise et de la Société
L'OCHRES exerce une mission d'observation des problèmes économiques et sociaux, particulièrement de ceux qui relèvent des interactions entre l'entreprise et la société.
Commentaires sur les évènements du trimestre
Les promesses de l’IA
Selon l’écrivain et philosophe Eric Sadin, « c’est très bien de s’émerveiller de l’efficacité de ChatGPT, mais a-t-on réfléchi à ce que diront les enfants lorsqu’ils estimeront inutile d’aller à l’école et de faire leurs devoirs ? » Il voit dans le développement de l’IA générative une mutation anthropologique et civilisationnelle dont la portée n’est pas vraiment appréhendée, et il juge les tentatives de régulation très insuffisantes. Il appelle même les citoyens à se révolter et à refuser cette mainmise technologique sur nos vies. De son côté, et dans le sillage du rapport Draghi de 2024 sur le nécessaire réveil technologique du Vieux continent, l’économiste Philippe Aghion énonce que l’Europe « ne peut pas se permettre de rater le train des nouvelles révolutions technologiques, à commencer par celle de l’IA, où nous disposons de tous les atouts pour réussir : des chercheurs de première qualité, la liberté comme valeur fondatrice, et un modèle social que le monde nous envie ».
Parmi les innombrables conséquences, a été observée une utilisation de ChatGPT pour hiérarchiser les religions entre elles, ce qui permet à certains influenceurs de proclamer la supériorité de l’islam (La Croix 11 juin 2025).
Les enfants d’abord ?
La haut-commissaire à l’Enfance s’est dite à nouveau effrayée par le développement de la tendance « no kids », consistant à exclure les enfants de certains lieux et commerces. Elle entend réagir contre cet état d’esprit, qu’elle estime néanmoins moins présent en France que dans d’autres pays, et elle se concerte pour cela avec différentes branches professionnelles.
« Alors que l’espérance de vie progresse et que la mortalité des plus âgés recule, notre pays connait une stagnation préoccupante de la mortalité infantile » : c’est le constat récent de l’INED, selon lequel la France a reculé dans ce domaine au 23 ème rang de l’UE, une chute marquée par rapport aux années 1990.
Il existe en France 7,6 millions de chiens. Certaines voix s’élèvent pour réclamer la création d’un congé de maladie pour animaux domestiques ainsi que le libre accès de ces derniers sur le lieu de travail. A noter que le vocabulaire est lui-même hésitant, car si les animaux domestiques semblent par définition confinés à la maison, en revanche un animal de compagnie devrait trouver sa place naturelle dans une entreprise, et pas seulement dans le secteur maritime ou l’assurance ! …
Les jeunes aiment le travail
Selon une récente enquête menée pour l’institut Montaigne auprès de 6 000 jeunes de 16 à 30 ans, et contrairement à l’idée reçue de la « grande démission », les jeunes expriment un fort attachement au travail. Mais ils font part aussi de grandes attentes de qualité de vie au travail et 66 % se disent insatisfaits pour différentes raisons (conditions de travail, management, rémunération ; 27 % déclarent avoir déjà subi du harcèlement moral). Ils ne révèlent aucunement un rejet général de l’autorité hiérarchique, mais ils sont souvent attirés par l’indépendance : 66 % envisagent de quitter leur entreprise dans les cinq ans, dont la moitié pour devenir travailleur indépendant.
L’IGAS a quant à elle étudié les pratiques managériales en entreprise en Allemagne, Italie, Irlande et Suède, et les a comparées aux réalités françaises pour en tirer ces observations : un management de qualité repose sur un fort degré de participation des salariés, sur une autonomie soutenue par la hiérarchie, et sur la reconnaissance du travail accompli ; en France les pratiques managériales sont plus verticales et plus hiérarchiques, la reconnaissance au travail plus faible et la formation des managers plus académique ; aucun de ces pays ne dispose d’une politique publique de management.
Faits religieux
Le Crif et l’Institut Supérieur du Travail ont fait réaliser début 2025 leur 3 ème baromètre du fait religieux en entreprise depuis 2018, qui révèle une plus grande acceptation de ces phénomènes par les jeunes arrivant sur le marché du travail. Ainsi, 70 % des salariés de 18 à 24 ans se disent favorables au port du voile en entreprise ! C’est seulement 20 % chez les 50-65 ans. Et 58 % des 18-24 ans sont favorables à l’ouverture de salles de prière en entreprise contre 19 % chez leurs ainés. Plus surprenant encore, 58 % des 18-24 ans jugent acceptable que quelqu’un ne serre pas la main d’un salarié de l’autre sexe (pourcentage en forte augmentation depuis 2021), contre 18 % chez les 58-65 ans. Comme on le sait, la grande majorité des faits religieux en entreprise se rattache à l’islam.
Santé morale
L’assurance maladie a diffusé ses chiffres d’action anti-fraude de 2024. Les fraudes ne se limitent pas aux assurés et aux cartes Vitale : 52 % des fraudes sont commises par des assurés pour 18 % des montants, et 27 % des fraudes sont commises par des professionnels de santé pour 68 % des montants. Les fraudes détectées et stoppées liées aux audioprothèses ont été multipliées par plus de 5 en un an pour atteindre 115 millions d'euros (contre 21 en 2023). L’assurance maladie a durci les sanctions en multipliant les radiations, les refus de conventionnement de centres d’audioprothèses et les poursuites pénales.
Et voici le droit de tuer
Le professeur J.L. Touraine, ardent promoteur de l’euthanasie depuis longtemps, s’était réjoui par avance : « Une fois qu’on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans, et dire qu’on veut étendre ce droit. » Cette loi sociétale introduisant en France l’euthanasie et le suicide assisté a donc été votée par l’Assemblée nationale, en dépit des nombreuses oppositions émises par la société elle-même. « Il va être plus facile d’obtenir l’euthanasie que d’avoir une consultation contre la douleur » alertait par exemple ce médecin. L’audace parlementaire a rompu les digues. Comme cet amendement adopté en commission spéciale, énonçant qu’"est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir". Pour couronner le tout, le législateur a sorti l’arme du délit d’entrave (2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende) pour condamner quiconque empêcherait ou tenterait d’empêcher de pratiquer une euthanasie ou empêcherait une personne de s’informer sur l’aide à mourir. Un proche ne pourra donc pas essayer de sauver celui qui va mal, de même un psychiatre son patient dépressif… Les opposants au texte ont critiqué cette fraternité à l’envers qui va fragiliser la prévention du suicide, et mettre à mal la non-assistance à personne en danger, et aussi la liberté d’expression d’une certaine façon.
La Conférence des responsables de culte en France – catholique, protestant, orthodoxe, juif, musulman et bouddhiste – avait peu avant lancé un appel à la responsabilité politique et humaine contre ce texte mortifère, pour les motifs suivants : « un langage qui travestit la réalité, une rupture avec l’essence du soin, des garanties éthiques et procédurales gravement insuffisantes, une menace directe pour les plus vulnérables, une atteinte à l’équilibre entre autonomie et solidarité. »
Le texte sera examiné par le Sénat en principe à l’automne.
Brutalisme
Le « brutalisme techno-ploutocratique » du président Trump (la formule est de L. Fabius) continue de se déployer aux USA et bien au-delà, comme l’ont montré entre autres sa tournée au Moyen-Orient et ses menaces répétées contre le Groenland ou le Canada. La Maison Blanche a diffusé quelques jours avant le conclave un photomontage de Trump déguisé en pape ; si le vice-président Vance n’y a vu qu’une « blague », beaucoup de catholiques américains ont désapprouvé ce mélange bouffon du vrai et du faux. Mais au fait, Trump est-il vraiment un Américain ? N’est-il pas un Martien, soutenu par la cinquième colonne des miliciens high tech tombés de la planète rouge chère à son ex-ami Musk, et agissant avec la complicité de son autre ami Poutine et de son armée anciennement rouge ? La lettre de l’ambassade américaine en France exigeant des entreprises étrangères de s’aligner sur la politique anti- diversité de Trump si elles veulent travailler avec l’Etat fédéral a fortement choqué, même si on sait bien que les actions DEI (diversité, égalité, inclusion) des entreprises et institutions américaines, imitées béatement par les grands groupes européens depuis 25 ans, ont souvent pris des proportions excessives depuis longtemps.
Vassalisation
Vance a reproché à l’Europe sa vassalisation permanente vis-à-vis des USA. Mais qui inonde le monde de coca cola et d’american way of life depuis des lustres ? Et qui sont les grands cabinets qui façonnent les canons du management et formatent l’économie à travers le monde ? Vu sous un autre angle, faut-il se féliciter d’entendre ces propos d’allure gaulliste ? Pas sûr.
Selon l’Office de protection de la Constitution rattaché au ministère allemand de l’Intérieur, l’AfD est une menace pour le pays ; aussitôt le secrétaire d’Etat américain Rubio a vu dans cette alerte une « tyrannie déguisée » et Vance « un nouveau mur de Berlin ». Savent-ils vraiment de quoi ils parlent ?
A peine connue la condamnation de Mme Le Pen par le tribunal dans l’affaire des assistants parlementaires, Poutine lui a apporté son soutien …bien encombrant. Trump et Musk ont fait de même.
Nouvel élan
Le pape Léon XIV appelle l’Eglise de France à un nouvel élan missionnaire, dans une lettre adressée à nos évêques. Il invite à s’inspirer de trois « saints pertinents face aux défis d’aujourd’hui », St Jean Eudes (1601-1680), le curé d’Ars et Ste Thérèse de Lisieux, « sous les vents contraires et parfois hostiles de l’indifférentisme, du matérialisme et de l’individualisme » ; il remercie les prêtres de France « pour leur engagement courageux et persévérant ».
Lors de la messe inaugurale de son pontificat, le pape a incité « la famille des nations à se fonder sur la famille, c’est-à-dire l’union d’un homme et d’une femme ».
Le jour de la Pentecôte il a déclaré que l’Église doit « ouvrir les frontières entre les peuples et abattre les barrières entre les classes et les races », et que les fidèles doivent « éduquer les passions qui s’agitent en nous ».
« Là où il y a l’amour, il n’y a pas de place pour les préjugés […], pour l’état d’esprit d’exclusion que nous voyons malheureusement émerger aussi dans les nationalismes politiques », a-t-il dit.
Antoine Sebaux