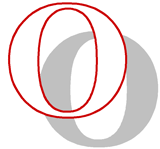Observatoire Chrétien de l'Entreprise et de la Société
L'OCHRES exerce une mission d'observation des problèmes économiques et sociaux, particulièrement de ceux qui relèvent des interactions entre l'entreprise et la société.
Grand corps malade
Le pape Léon XIV a publié récemment l’exhortation apostolique Dilexi te, dans laquelle il jette un cri d’alarme sur la pauvreté dans le monde et propose l’attention active en faveur des pauvres comme une voie préférentielle de sainteté. Parallèle-ment, le Secours catholique de France publie un rapport sur les trente dernières années de son action, dans lequel il pointe une intensification continue de la pauvreté.
Le bureau de l’Ochres est parvenu à la conviction que cette pauvreté déjà impressionnante va devenir massive dans le futur en France. C’est pourquoi il a retenu comme thème de sa prochaine matinée, le 14 février 2026, à Saint-Pierre du Gros-Caillou, une réflexion sur ce que devraient faire les chrétiens pour faire face à cette situation. À ses yeux, en effet, un niveau élevé de pauvreté, que l’on ne parvient pas à faire baisser, est le syndrome d’une société malade. Et, quand les pauvres souffrent, quand les situations de précarité se multiplient, tout le corps social est atteint.
Au cours de cette matinée, on dira pourquoi cette conviction s’est forgée, en exami-nant quelques données sur lesquelles elle se fonde. On montrera, à la faveur de quelques exemples, comment la pauvreté qui progresse dans certains secteurs de la société a des répercussions graves sur la société tout entière.
Mais si toute la société doit prendre conscience de ce que combattre la pauvreté se-ra positif pour l’ensemble du corps social, on peut attendre des chrétiens qu’ils com-prennent les enjeux de cet engagement et qu’ils saisissent leurs responsabilités : ré-flexion, engagement, témoignage ; et pas seulement à partir du partage des ressources matérielles, mais en explorant l’accompagnement, la nature des problèmes et des solutions, l’exercice de la justice, un rôle dans l’éducation, … La rencontre physique avec des pauvres est aussi une voie à mieux révéler dans toute sa promesse d’humanité, indispensable pour avancer vers une société plus allante et plus solidaire.
Hervé L’Huillier