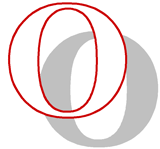Observatoire Chrétien de l'Entreprise et de la Société
L'OCHRES exerce une mission d'observation des problèmes économiques et sociaux, particulièrement de ceux qui relèvent des interactions entre l'entreprise et la société.
La matinée de l'OCHRES du 25 janvier 2025
Pour une pratique démocratique constructive
Comment et jusqu’où la faire vivre dans la cité, les entreprises, les Églises ?
La matinée organisée par l’Ochres le 25 janvier dernier a largement rempli son objectif. On trouvera ci-dessous un essai de synthèse, essentiellement composé à partir des notes prises par Catherine Robert, parfois complétées par le texte des intervenants quand nous l’avons obtenu. Le père de Longeaux, curé de Saint-Pierre du Gros-Caillou, qui accueillait cet événement, a ouvert cette matinée en reformulant ainsi le thème de ce débat : comment allier la culture du dialogue et la prise de décision, ou, pour l’Église, la synodalité et la culture hiérarchique. Il fait référence à Aristote : l’acte libre est la délibération qui aboutit à une décision.
Hervé L’Huillier : Débattre pour faire, repères chrétiens pour une œuvre commune
Nous constatons dans notre pays et ailleurs des signes d’un affaiblissement de la capacité à débattre et décider ensemble. Cet essoufflement de ce que l’on peut appeler le dialogue démocratique se constate dans la plupart des sphères de la société. Il est marqué par au moins trois caractéristiques : la violence dans les échanges, la contestation des décisions prises, et la multiplication des comportements autoritaires. Ceci nous inquiète en tant que citoyens, et plus encore en tant que chrétiens. Car nous pensons que le débat démocratique est nécessaire et possible, dans sa fonction de régulation des fonctionnements sociaux.
En nous fondant sur des références fortes de la pensée sociale chrétienne pour orienter nos échanges de ce matin, nous pouvons retenir quelques « notes hautes » auxquelles attacher ce débat. J’en propose trois.
Adunation
L’adunation, si je puis oser cette invention à partir du latin adunatio, est l’art de fabriquer la communion. La communion est l’idéal de la société. Elle est la clef de voûte de toute la pensée sociale chrétienne. La communion est notre devoir : nous devrions tous nous former comme compagnons du devoir de communion. Nous prions pour l’adunation à chaque eucharistie après le Notre Père : « conduis-la vers l’unité parfaite » (pacificare et coadunare digneris). La synodalité est une forme de l’adunation. Évidemment cela devient compliqué si l’esprit de communion se réduit à défendre les intérêts de collectifs particuliers plus ou moins exclusifs les uns des autres (voir les propos de saint Paul sur le corps et ses organes).
Dignité
L’un des principes fondamentaux de la pensée sociale chrétienne est la dignité de toute personne. Elle est l’idéal de la considération de la personne, elle-même remplie de vie, de dons et capable de Dieu. Reconnaître cette dignité est aussi un devoir : nous devrions tous nous former comme compagnons du devoir d’estimer autrui. La dignité n’est pas pour soi. Elle est orientée vers la communion. C’est que la dignité de la personne trouve sa réalisation parfaite dans le don de soi à la communauté. Elle implique de la part de la société le principe de participation, la mise en commun des talents. Organiser la participation vise à donner à chacun les voies et moyens d’un don de soi réussi. Évidemment tout cela devient difficile si chacun revendique une dignité de profil bas, au service de ses propres intérêts, et nous avons tous cette tentation (voir les propos de Saint Paul sur les dons de l’Esprit).
Concertation
Nous le voyons : dans tout projet, y compris le projet de faire société, construire la communion en considérant la dignité de chacun crée des frottements, des amputations, des sacrifices, des frustrations, …, et donc des tensions qui peuvent aller jusqu’à la violence. Il ne faut pas s’en alarmer à l’excès tant que cela peut se régler par une saine pratique de la concertation. Faisons un petit détour par l’étymologie : concertare = lutter. C’est le sens premier. Confronter. Mais dans la version française de concertation, c’est devenu débat, discussion, dialogue, dia-logos, avec la référence au Logos, au Verbe, dans lequel nous reconnaissons parole, raison, amour, vérité, justice, création, sagesse, … Puis le mot concertare a donné concert, jouer et chanter ensemble, trouvant là son accomplissement, l’harmonie réalisée : les musiques du ciel sont concertantes et parfaites, car chaque élu y joue sa partition dans et pour la construction d’ensemble.
Organiser la concertation
L’organisation de la concertation est donc la clef de tout projet. Je souligne quelques points d’attention, conditions indispensables, dont aucun à lui seul ne saurait suffire pour assurer le résultat.
Exercer l’autorité, garantie permanente de l’objectif final, car l’autorité est la capacité de faire prévaloir l’adunatio et la dignité de chaque acteur.
Instituer des règles et une méthode, tracer les chemins pour aller au but, pour ne perdre personne et favoriser la participation
Comprendre la logique de l’autre : « entrer dans la demeure de l’autre », comme Jésus chez Zachée ou chez Simon ; cela acte la volonté de dialoguer.
Donner sa place à la modération/conciliation, qui marque la confiance en l’autre et la foi en l’objectif fixé
Être dans la vérité, pour pouvoir avancer ‘pari passu’, c’est-à-dire d’un pas égal, être tous « en phase », sans traîner des arriérés, des non-dits, des difficultés non aplanies
Rendre compte, la fameuse accountability des anglo-saxons, non pas seulement pour faire un rapport sur ce qui a été réalisé, mais pour montrer comment ce qui a été réalisé concourt positivement à l’objectif final
Trouver sa récompense et sa réputation dans le résultat commun, car attention à la recherche de valorisation des ego ; non pas sculpter prioritairement sa propre statue, mais être « auréolé » de l’accomplissement obtenu tous ensemble.
Tout cela, nous allons essayer de le repérer, de l’ajuster, d’en voir les difficultés, les possibilités réalistes, dans les cas de figure que nous nous proposons de regarder ensemble, en commençant par l’exemple de la réparation de Notre-Dame de Paris, dont chacun ici mesure la complexité et le contexte de pression multiple qui l’ont caractérisée. C’est au point que si le dialogue et la décision ont pu fonctionner pour le résultat que nous voyons dans ce grand chantier, il n’y a pas de raison que cela ne marche pas dans des cas de figure plus simples.
Philippe Jost, Dialogue et décision pour réparer Notre-Dame
Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, cite un proverbe chinois : quand on veut construire sa maison, on ne demande pas son avis à tous les passants. Il fallait tout à la fois beaucoup de concertation, car c’était une aventure collective, mais aussi de décisions pour la faire avancer. A titre de comparaison, la cathédrale de Nantes touchée par un incendie en 2020 n’est toujours pas rouverte. Après l’incendie de Notre-Dame, en 2019, la rebâtir en cinq ans paraissait une folie. Les facteurs de succès ont été l’engagement du Président de la République sur ce délai, le financement acquis par le mécénat et l’élan de générosité populaire, l’objectif clair, la maîtrise d’ouvrage ajustée avec la création d’un établissement public dédié, la personnalité du général Georgelin, autorité reconnue et catholique convaincu, l’existence en France de tous les savoir-faire nécessaires. En lui succédant, P. Jost n’a pas cherché à être son clone mais le mode de conduite n’a pas changé !
Un premier débat épineux a porté sur la restauration de la flèche. Tous les architectes consultés étaient favorables à la restauration à l’identique. Il a fallu laisser du temps au temps pour que cette solution s’impose à tous. Les codes applicables ont été utilisés sans loi d’exception.
Pour finaliser le projet, il a fallu trois ans quand les travaux eux-mêmes ont duré seulement deux ans grâce à la coactivité des différents corps de métiers. P. Jost insiste sur l’importance de l’humain dans la réussite du chantier : effet Notre-Dame, adhésion générale, qu’on soit croyant ou non, lien de confiance entre tous, respect de l’unité, proximité, solidarité, sentiment d’être partenaires, de vouloir réussir ensemble.
Quand des obstacles ont surgi, la concertation a permis de les surmonter, qu’il s’agisse du problème du plomb grâce aux explications devant le Comité plomb de la Ville de Paris, de l’archéologie préventive par la rencontre avec ses artisans, de la charpente grâce au partenariat avec l’ONF pour la fourniture des chênes ou des relations entretenues avec l’Inspection du travail avec l’objectif commun d’éviter les accidents (il y a eu deux mille ouvriers sur ce chantier). Il fallait prendre les difficultés à bras le corps, mener la concertation pour lever des hostilités, pour ensuite prendre une décision, en autorité, qui ne soit pas forcément un consensus. La méthode suivie a été « d’embarquer » toutes les parties au projet, de comprendre et respecter leurs attentes et de les rendre acteurs du succès final. En définitive, il n’y a pas de contentieux pour ce chantier.
Bertrand Cuny – Louis Sangouard : Comment faire vivre le débat démocratique dans la cité ?
Ancien maire de Saint-Cloud, directeur à la DATAR de 1976 à 1981, Bertrand Cuny est entré en politique, exclusivement communale, en rencontrant Jean-Pierre Fourcade, de centre droit, élu maire de Saint-Cloud en 1971. Deux visions de l’avenir de la ville s’étaient alors affrontées, le maire sortant, de même couleur politique, voulant continuer à développer sa ville en construisant de grands ensembles de logements et des bureaux alors que JP Fourcade voulait limiter la population aux 30 000 habitants atteints. Sa liste l’a emporté, les habitants ont choisi leur avenir loin des considérations politiques ou de personnes : un bel exemple de débat démocratique. Élu maire à son tour en 1992, B. Cuny a exercé son mandat jusqu’en 2005, il déclare avoir été un maire heureux. Il en tire quelques enseignements : l’important c’est de s’écouter les uns les autres en essayant de se convaincre, il faut respecter l’opposition et que la majorité tranche en dernier ressort. Il formule quelques suggestions : rétablir la taxe d’habitation dont la suppression a diminué l’autonomie des communes, rétablir le cumul député-maire qui rendait le député plus proche de ses électeurs, diminuer le nombre des structures intermédiaires entre l’État et les communes.
Ancien conseiller municipal de Gif-sur-Yvette, venu à cet engagement par son appartenance au MCC, Louis Sangouard a effectué cinq mandats, en tant qu’élu d’opposition (PS), face à un maire de droite. Mais cette opposition s’est avérée constructive pendant toute la période où le maire s’est montré ouvert, faisant aboutir certains de ses projets. Deux approches sont possibles de la part de la municipalité : soit décider seule, car légitimement élue, soit consulter la population à tous bouts de champs. Il faut mêler les deux, selon différentes modalités, jusqu’à l’association des habitants à l’élaboration du budget. Mais pour la procédure référendaire, il faut s’assurer que tous puissent vraiment y participer, même les catégories les plus éloignées de la vie communale. Tout cela demande beaucoup de temps, de sensibilisation, de débat, loin d’une logique purement électoraliste. Il cite Dom Helder Camara : « Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve alors que lorsqu'on rêve à plusieurs c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'Histoire ».
Les deux sont d’accord : la politique communale fonctionne bien, quelle que soit la coloration politique, de vrais dialogues s’instaurent avec la population, il n’y a pas besoin de règle pour limiter les mandats, ce sont les électeurs qui tranchent.
Michel Sarrat – François Pouzeratte : Comment faire vivre la pratique démocratique dans l’entreprise ?
Michel Sarrat, codirigeant de l’entreprise familiale de transport routier GT, employant deux mille personnes, évoque la subsidiarité et la synodalité. Il se dit inspiré dans sa pratique par deux patrons, Bertrand Martin, chez Sultzer, et Jean-Dominique Senard, chez Michelin. La confiance et la responsabilité sont les ingrédients nécessaires à toute réussite d’entreprise. Les chauffeurs routiers sont plutôt mal vus. Pour leur permettre de donner du sens à leur métier, différents outils ont été mis en place dans cette entreprise : en 1965, un premier service de formation interne, en 1968 une école de formation et des accords d’intéressement, en 1993 l’actionnariat des salariés et à partir de 2012, une démarche d’organisation de l’entreprise visant à favoriser l’autonomie, la confiance et la responsabilité des équipiers. Elle applique la subsidiarité avec des équipes de conducteurs autonomes qui organisent le planning du travail, les congés, la maintenance des véhicules, les remplacements. Ces équipes participent même au recrutement comme cela s’est produit pour le directeur d’une filiale d’entretien. Cette procédure collaborative réussit à condition d’exposer clairement le but poursuivi, de donner aux personnes le moyen de « faire le job », de relire avec eux comment cela s’est passé. À cela s’ajoute, pour le dirigeant, écouter vraiment ses équipiers, ce qui rejoint la démarche synodale dans l’Église.
Entre 2014 et 2016, s’est engagée une réflexion sur la raison d’être de l’entreprise, proposant aux salariés d’y participer. Une première journée de travail a réuni cent vingt personnes, pour les 2/3 des conducteurs routiers. Leurs apports ont été synthétisés puis approfondis et plus de trois cents personnes ont travaillé sur sept thèmes fondateurs de l’avenir de l’entreprise. Les résultats ont été mis en commun lors d’une session rassemblant cent quarante personnes pour dessiner les dix années à venir. Ce processus collaboratif aide à « bien décider ensemble » en éclairant les décisions que chacun doit prendre à son niveau de responsabilité.
François Pouzeratte, associé d’Eurogroup,
société de consultants qui compte trois mille personnes, aborde le sujet de la participation de tous au plan stratégique de l’entreprise. Il rappelle en préambule que l’entreprise est mortelle : son âge moyen de survie est de vingt ans. Et le turn-over des salariés atteint jusqu’à 30% depuis les années 90. La définition de la stratégie a changé, elle ne relève plus de la seule autorité du chef d’entreprise assisté de son Comex. La gouvernance a évolué vers une gouvernance ouverte, avec la mise en place de la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise), des normes européennes de reporting, des divers comités qui entourent les dirigeants, des consultations pour impliquer le plus grand nombre. Deux exemples : ENEDIS, avec 35 000 employés a engagé une démarche très participative au plus près du terrain ; en deux mois, 140 000 témoignages ont été recueillis. Sa présidente s’est engagée à respecter la parole exprimée. La FDJ (Française des Jeux) : lors de sa fusion avec deux entreprises similaires d’Irlande et de Suède, pour définir un projet de raison d’être de la nouvelle entreprise. F. Pouzeratte conclut : le management est un art politique mais la grande crise que traversent les institutions politiques n’existe pas dans les entreprises, le management a suivi la demande de participation.
Cette démarche de participation ne risque-t-elle pas d’être taxée de paternalisme ? demande Jean-Luc Mouton. C’est un mot daté et dépassé, de l’avis même de syndicalistes, répond M. Sarrat. Mais elle peut être déstabilisante pour les cadres car accepter ainsi le dialogue les percute.
Cette démarche est-elle possible dans les groupes internationaux et qu’en pensent les syndicats ? Pour F. Pouzeratte, la gouvernance ouverte doit faire place à la fois aux syndicats et aux employés mais c’est vrai que les syndicats peuvent se montrer réticents. Dans les groupes internationaux, il faut que les entreprises soient suffisamment autonomes pour avoir ces pratiques.
Anne-Laure Danet – Hervé Legrand : Comment faire vivre la pratique démocratique dans les Églises ?
Culture du débat et prise de décision dans les Églises de la Réforme.
Anne-Laure Danet, pasteure, responsable des relations avec les Églises chrétiennes, montre que le système presbytéro-synodal est en place dans les Églises protestantes depuis quatre siècles, c’est-à-dire au niveau paroissial un conseil presbytéral élu, et au niveau national une réunion de pasteurs et de laïcs. Mais, pour les protestants, la priorité n’est pas l’Église en tant qu’institution, c’est l’Évangile. L’organisation, qui doit favoriser la traduction de la Parole reçue en actes concrets, est laissée prioritairement à l’échelon local : le culte et l’entraide sont la parole de Dieu proclamée pour la recherche du bien commun. Deux principes sont fondamentaux : la liberté de conscience et la responsabilité. La foi est d’abord une affaire individuelle. Le sacerdoce est universel : par le baptême tous sont prêtres. Il n’y a pas de dogmes, mais des principes dynamiques. L’autorité suprême est celle des Écritures. Les structures sont collégiales. L’autorité n’est pas à sens unique, elle est collégiale et partagée. Jamais un individu ne décide seul, les laïcs et les pasteurs ont la même participation. La démocratie ne s’en tient pas à la majorité. C’est la culture du débat, il n’y a pas de dernier mot. Fraternité et collégialité ne vont pas de soi, l’enjeu est de regarder ensemble. Pour cela, dans les assemblées, on ne recherche pas systématiquement un consensus : l’expression des désaccords est aussi importante que la formation d’un accord. La Parole de Dieu étant le recours ordinaire, ces assemblées sont aussi lieux de formation.
Le volet œcuménique est présent dans le Synode actuel. Il y a une volonté d’apprendre à se connaître en tant que croyant, de voir dans l’autre ce dont on peut s’enrichir. Deux avancées dans l’œcuménisme : d’une part, le consensus différencié, c’est-à-dire l’accord sur un point essentiel de la foi, par exemple la justification, sans vouloir supprimer toutes les divergences et, d’autre part, la guérison des mémoires, comme en 2017 face au 500e anniversaire de la naissance de la Réforme.
Vers une gouvernance synodale généralisée de l’Église catholique.
Le Père Hervé Legrand, OP, ancien responsable des études doctorales de théologie à la Catho, ecclésiologue, a participé au dernier Synode. Il relève que les innovations de la société ont peu à peu émergé dans l’Église. Le Synode a été ouvert aux laïcs (2/3 des participants) et aux femmes, une cinquantaine, malgré ce que dit saint Paul de la présence des femmes dans les assemblées. Il a été un lieu de débat, préparé par une information de tous les participants avant sa tenue, de libre prise de parole, de discussions, de négociation et de respect des minorités pour arriver à un consensus (à la différence du synode protestant). Jusqu’ici la pratique synodale avait une très modeste place dans l’Église. Le dernier Synode change radicalement la gouvernance de l’Église. Elle était trop cléricale (par exemple, l’encyclique Humanae vitae a éloigné de l’Église beaucoup de catholiques), trop archaïque par rapport à la société contemporaine. Le dernier Synode n’a rien décidé sinon une nouvelle manière de décider : écoute de tous, rendre des comptes à tous les niveaux à la fois sur la gestion comptable et sur la gestion spirituelle et pastorale, discussions collégiales à tous les niveaux. Le curé de paroisse doit décider avec ses conseils, pastoral et économique. Pour cela cependant, les laïcs ne sont pas suffisamment formés. Le changement de gouvernance est un enjeu de taille car l’Église ne sait pas parler aux gens d’aujourd’hui dans un univers sécularisé. Il y a seulement 2,5% de Français catholiques pratiquants allant à la messe le dimanche.
Qu’en retenir ?
Les intervenants à cette matinée ont montré que, non seulement le débat démocratique est possible dans des contextes variés, mais aussi qu’il peut se révéler efficace. On retient ici quelques réflexions qui peuvent constituer des sujets d’attention pour que cette possibilité prenne de la consistance et puisse s’ouvrir à des sphères plus étendues.
D’abord, il convient de noter que cette pratique correspond à une demande sociale actuelle. Dans l’entreprise, la question n’est pas neuve ; c’est celle de l’art de l’articulation entre top down et bottom up. Mais la démarche lancée dans l’Église catholique sur la synodalité va dans le même sens ; on sait qu’elle a ses prodromes dans les réflexions du concile Vatican II. Dans le monde politique, la difficulté à installer une culture du débat a donné lieu ces dernières décennies à la publication de nombreux ouvrages.
L’exposé de Philippe Jost a répondu à une question qui revient souvent : complexité et technicité sont-elles un obstacle à un large dialogue ? Dans l’exemple de la réparation de Notre-Dame, c’est pratiquement l’inverse : la discussion dans laquelle chaque acteur avait sa place a été une condition sine qua non du succès. Dans l’exemple cité par Michel Sarrat, on a vu que les chauffeurs-conducteurs ont pris une part importante dans le dialogue interne à l’entreprise (Jean-Louis Borloo disait qu’il faut veiller à ne pas trop éloigner le gratin des nouilles).
Cela invite à ne pas se représenter le rapport gouvernants-gouvernés de façon trop simpliste. Une modification de la gouvernance ne vise pas seulement les structures de direction. Dans bien des cas, c’est la pratique globale qui est bousculée par la volonté de favoriser un comportement démocratique : dans l’entreprise, le rôle de l’encadrement intermédiaire et des syndicats est remis en question. Il en sera de même dans l’Église catholique, dans laquelle la démarche synodale va secouer les échelons intermédiaires.
De ce fait, l’exigence du débat invite à quitter les postures de « chasses gardées », d’intervenants majeurs, à plus forte raison de « lignes rouges » et de « non négociable ». C’est envisageable si l’objectif commun s’impose à tous les acteurs, si tous en comprennent la nécessité et si chacun rejette la prétention à avoir raison contre tous les autres. L’objectif commun doit donc être clairement affiché dans toute ses composantes. L’absence de vision est sans doute un des facteurs-clés de l’échec du débat démocratique. L’échange sur la pratique du débat dans une commune l’a clairement montré. Sous cet aspect, le débat considéré comme un objectif en soi, ce que l’on peut percevoir dans les exposés sur les églises (dans la démarche synodale, l’Église a vocation à devenir synodalité), ouvre un champ particulier et ne saurait être transposable à tout domaine.
Car les activités humaines ont besoin de décision et d’avancées palpables, pour ne pas dire de résultats concrets. Cela pose la question du temps du débat. Dans le cas de Notre-Dame, le fait que la préparation du chantier ait demandé plus de temps que le chantier lui-même est un enseignement majeur : en cela s’exprime la capacité à entendre tous les acteurs, leurs remarques, l’expression de leurs attentes et de leurs contraintes, ainsi que la manière dont ils devaient interagir.
A plusieurs reprises, les intervenants ont souligné la nécessité de formation. Sans doute est-ce indispensable pour construire un dialogue équilibré. Sans doute une partie de la violence vient-elle de l’inégalité des compétences quand tout le monde veut s’exprimer. Mais sachons bien de quoi nous parlons : il ne s’agit pas principalement de « formation à l’écoute », mais bien de formation aux fondamentaux des projets dans lesquels on se lance. On comprend bien, par exemple, que n’importe qui ne peut pas intervenir dans un débat sur la liturgie sans compréhension de ce qui s’y joue ; même chose sur le logement social ou sur la filialisation d’une activité dans une entreprise. Le besoin de formation est indispensable si on attend des acteurs une forme de responsabilité.
En conclusion, il apparaît que le choix du débat, réel, constructif, n’est pas la voie de la facilité. C’est une voie d’exigence, mais elle est conforme à la dignité de tous et fabrique, mieux que toute autre voie, la communauté humaine.
Hervé L’Huillier
_____